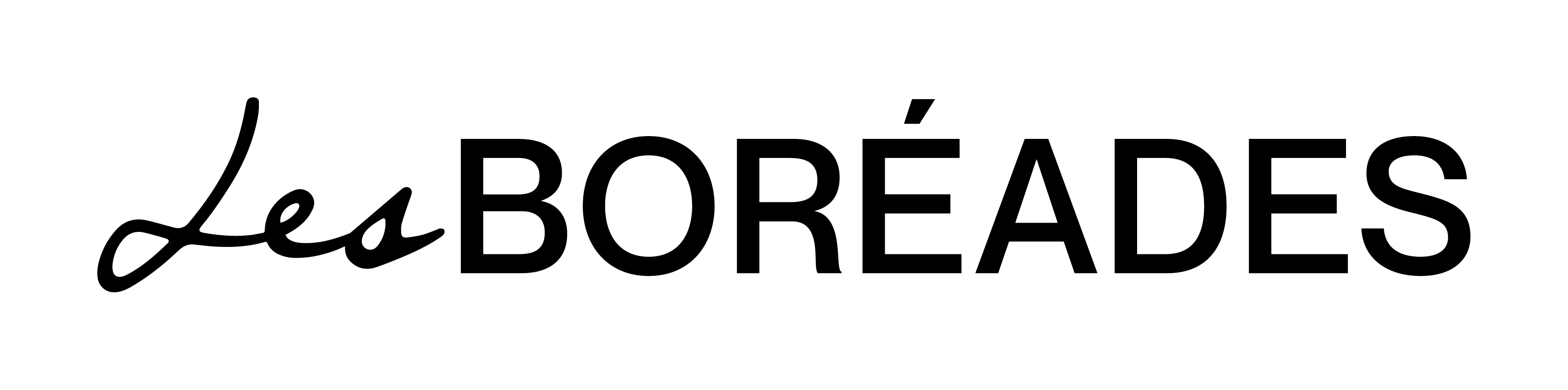La musique à Naples: une vocation existentielle
En prévision du concert Naples la sensuelle du 19 février prochain à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, nous vous proposons la note de programme rédigée par François Filiatrault.
[blockquote text= »La musique est à Naples l’inévitable colonne sonore qui accompagne la vocation existentielle de cette ville spectacle par excellence.
– Dinko Fabris, Naples, ville spectacle du XIVe au XIXe siècle, 1999.
» text_color= » » width= »75″ line_height= »undefined » background_color= » » border_color= » » show_quote_icon= »yes » quote_icon_color= » »]
Naples connaît au XVIIIe siècle un apogée musical sans précédent, aboutissement de plusieurs siècles de réalisations originales dans tous les genres. La quantité de compositeurs et de musiciens qu’elle abrite alors est proprement phénoménale. Ses quatre prestigieux conservatoires forment une élite de chanteurs et d’instrumentistes qui essaimeront dans toute l’Europe, car les institutions de la ville, pourtant nombreuses, comme la Chapelle royale, les maisons princières et les établissements religieux, ne suffisent pas à les engager tous. Sans doute à cause d’une remarquable continuité artistique, on a parlé après coup d’école napolitaine, dont Alessandro Scarlatti aurait été le fondateur, mais il s’agit d’un concept un peu réducteur, compte tenu de l’extraordinaire diversité de la production musicale de la cité parthénopéenne.
C’est dans le domaine de l’opéra que les Napolitains se distinguent au premier chef. Dès la fin du XVIIe siècle, remplaçant le modèle vénitien, ils imposent à l’Europe entière – sauf en France – l’opera seria, où, dans une succession de récitatifs et de grandes arias caractérisées, chantent dans des décors et des costumes tout à fait baroques les dieux, déesses et héros de l’histoire antique par la voix des castrats et des cantatrices adulés du public. Les maîtres napolitains inventent également la comédie en musique, ou opera buffa, qui font vivre sur des musiques légères et ingénieuses des personnages plus vrais que nature dans des situations de la vie quotidienne traversées par les intrigues et les quiproquos les plus cocasses.
À côté de la riche production vénitienne dans les genres instrumentaux, Naples fait sur ce plan pâle figure, du moins en ce qui regarde la quantité. Pourtant, ses musiciens ont écrit quelques concertos, surtout pour la flûte à bec, la traversière et le violoncelle, qui allient la vocalità, où ils ont fait leurs preuves, à un souci contrapuntique qui pourrait sembler archaïque s’il n’était associé à une sensualité harmonique et à une souplesse expressive uniques.
À la fin de sa vie, et après avoir écrit avec une fécondité stupéfiante dans tous les genres vocaux, Alessandro Scarlatti assiste à la baisse de popularité de ses œuvres scéniques. Se mettant alors à la musique instrumentale, il compose d’éblouissantes toccatas et variations pour clavecin, un ensemble de concertos grossos ainsi que sept « sonates » pour flûte, deux violons et basse continue, tandis qu’un manuscrit au curieux titre de Sinfonie di concerto grosso propose en 1715 douze compositions où se mêlent vents et cordes.
Mais ceux-ci ne sont pas à strictement parler des concertos grossos à la manière de Corelli et où, comme on l’a naguère écrit, les violons du concertino auraient été remplacés par les vents. Ceux-ci, en effet, ne font qu’apporter leurs couleurs à la texture de l’ensemble, parfois par des jeux de brèves questions et réponses, parfois dans un esprit déjà symphonique. Il n’y a pas à proprement parler pour eux de passages solistes, sauf dans les mouvements lents, ni rien qui fasse vraiment briller la virtuosité. L’écriture est parfois capricieuse, et les mouvements les plus accomplis demeurent ceux écrits comme des fugues. Pour reprendre la description d’Olivier Rouvière, ces œuvres, qui se terminent par des danses simples et bien troussées, se distinguent tout à la fois par leur « pittoresque mélancolique », leurs « adagios rêveurs », leur « verve rythmique » et leur « jeu de contrastes ».
Comptant parmi les plus prestigieux pédagogues de son temps, Francesco Durante, né en 1684 à Frattamaggiore, près de Naples, est un des très rares compositeurs napolitains à n’avoir jamais écrit pour la scène. Dans le cadre de ses activités d’enseignement, il compose des duos vocaux, tandis que dans sa musique religieuse se mêlent la stricte écriture contrapuntique et l’expression obtenue par le chromatisme et l’ornementation virtuose. Sa production instrumentale consiste en pièces de clavecin conçues comme des études et en huit Concerti per quartetto demeurés manuscrits. Composés vers 1740, ces concertos pour cordes juxtaposent dans une grande liberté des éléments du Baroque et des tournures qui annoncent la symphonie classique. Certains mouvements sont de véritables fugues – le Ricercar du Concerto nº 4 en témoigne –, mais Durante insuffle au contrepoint un caractère dramatique très personnel, tandis que des motifs tour à tour expressifs et galants émaillent les différents mouvements. Est-ce à cette hybridation que faisait allusion le musicien allemand Joachim Quantz, pourtant leur grand admirateur, quand il fustigeait la présence d’un « goût de l’extravagance et du bizarre » dans la production de certains maîtres italiens ? D’autre part et pour la petite histoire, on rapporte que Durante est mort, en 1755, d’une indigestion de melons.
On ne sait presque rien de la vie de Nicola Fiorenza si ce n’est que, né vers 1700, il enseigne les instruments à cordes au conservatoire de Santa Maria di Loreto de 1743 à 1762, année où il est congédié pour mauvais traitements envers ses étudiants. Il est également violoniste à la Chapelle royale à partir de 1750 et il en sera le premier violon huit ans plus tard. À part deux cantates d’attribution douteuse, son œuvre est exclusivement instrumentale, cas unique chez les maîtres napolitains. Elle consiste en une trentaine de compositions, dont neuf sinfonie avec instruments solistes et quinze concertos pour flûte à bec et pour violoncelle. Bien qu’il garde l’ancienne structure en quatre mouvements, Fiorenza fait une synthèse très personnelle de l’esprit vénitien et de la sensualité napolitaine; le mélancolique premier mouvement de son Concerto en la mineur, daté de 1726, dérive de Scarlatti, tandis que ses Allegros énergiques montrent l’influence de Vivaldi.
Né en 1710 à Jesi, près d’Ancône, Giovanni Battista Pergolesi est d’abord élève, entre autres maîtres, de Durante au conservatoire Dei Poveri di Gesù Cristo. Il n’aura le temps d’occuper par la suite que des postes secondaires, principalement ceux de maître de chapelle du prince Colonna Stigliano et du duc Carafa Maddaloni, car il meurt de tuberculose à vingt-six ans. Ce qui ne l’empêche pas de créer en moins de cinq ans des chefs-d’œuvre dans tous les genres vocaux : son intermède bouffe La Serva padrona et son émouvant Stabat Mater, commande d’une congrégation religieuse, vont connaître durant des décennies un retentissement européen. L’immense renommée qui est la sienne après sa mort prématurée amène nombre d’éditeurs à publier sous son nom des compositions qui ne sont pas de lui, particulièrement dans le domaine instrumental, qu’il a bien peu cultivé. À part un Concerto pour violon et une Sonate pour clavecin, toutes les œuvres instrumentales qu’on lui a attribuées sont apocryphes, y compris le charmant et très préclassique Concerto pour flûte en sol majeur…
© François Filiatrault, 2015
Alessandro Scarlatti par Les Boréades de Montréal
[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color= » thickness=’15’ up= » down= »]
[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color= » thickness=’15’ up= » down= »]