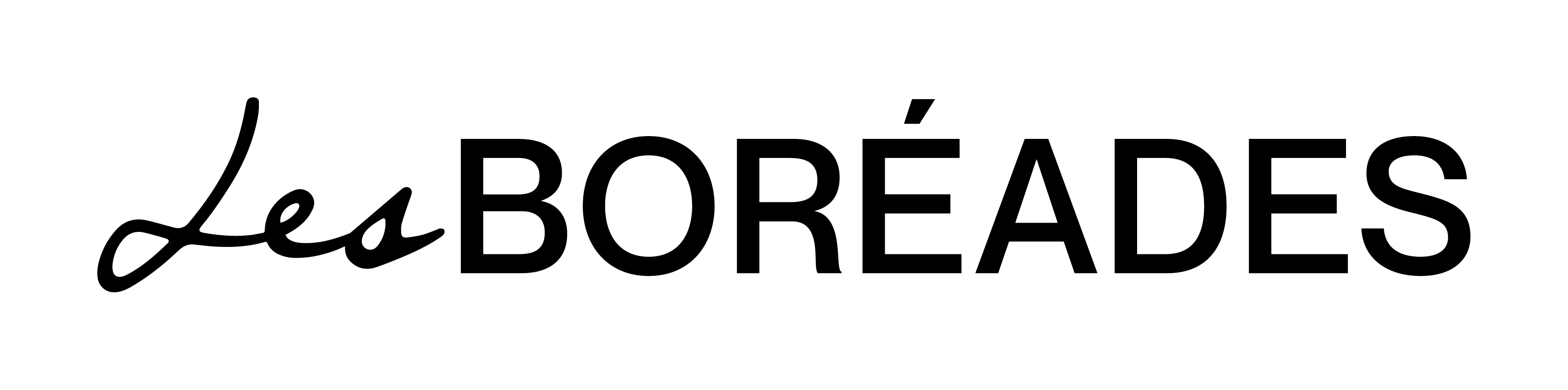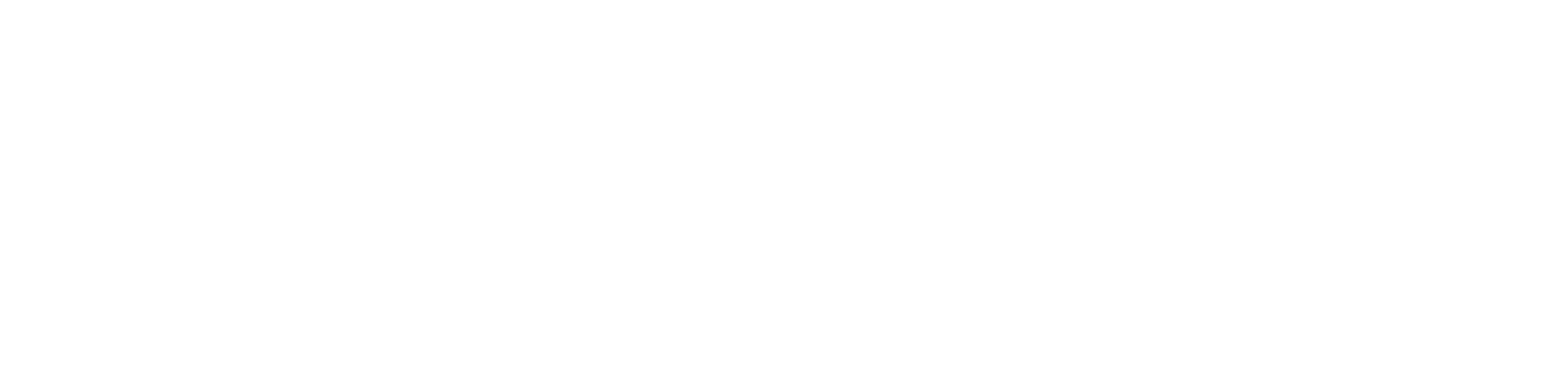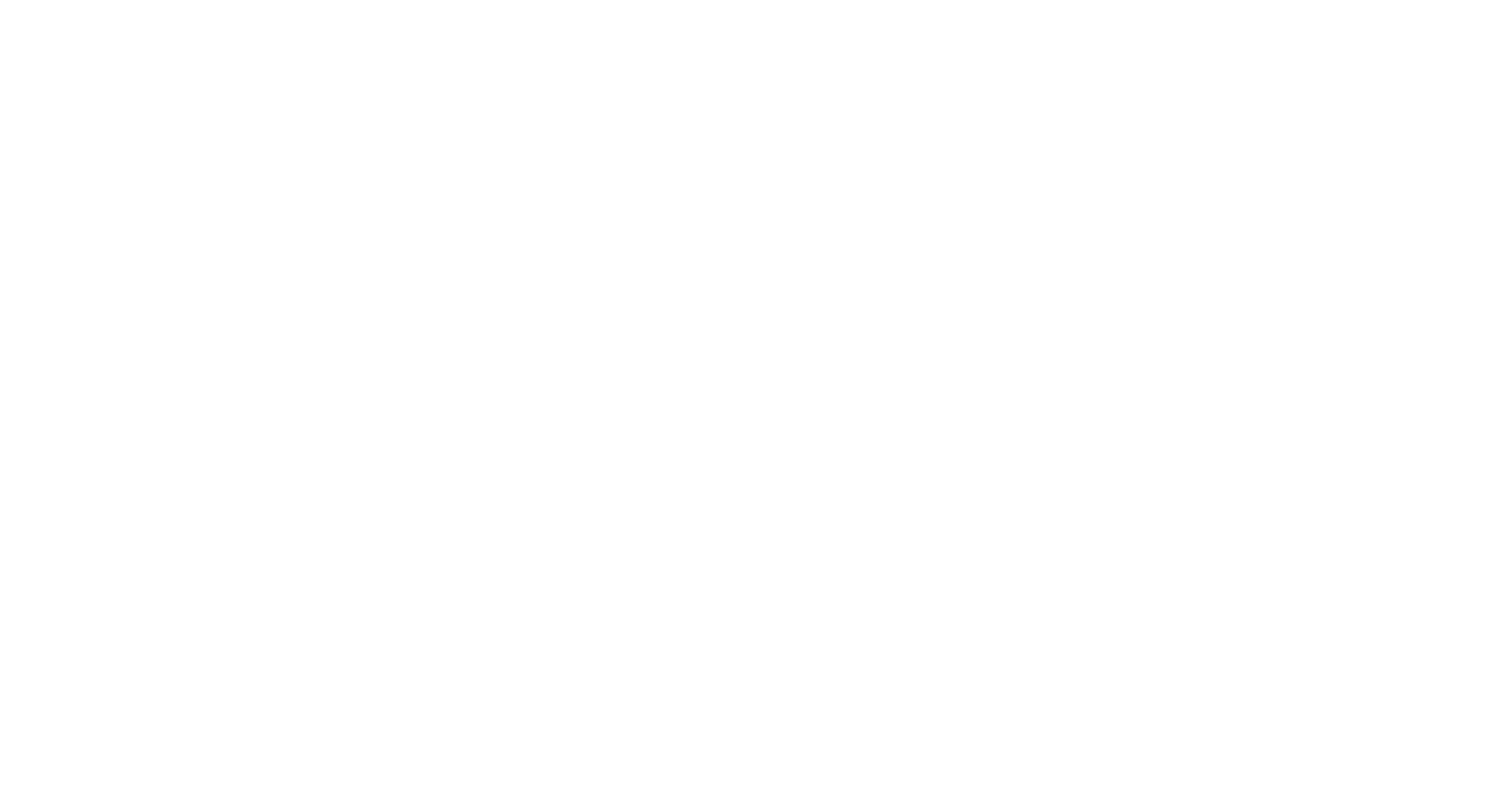LE CONCERT SPIRITUEL À SES DÉBUTS LES PREMIERS CONCERTS PUBLICS
Bien qu’il passe souvent inaperçu, le travail des institutions et des sociétés contribue, dans bien des domaines et tout autant que les créateurs eux-mêmes, aux évolutions esthétiques et à la diffusion qui caractérisent chaque époque. Nous verrons que, première grande organisation de concerts publics de l’histoire, le Concert spirituel a non seulement reflété le goût musical des Français au XVIIIe siècle et témoigné des grandes transformations de la musique en Europe à cette époque charnière de l’histoire, mais qu’il a contribué puissamment à donner à la musique instrumentale l’autonomie que nous lui connaissons aujourd’hui.
C’est Anne Danican Philidor, fils du bibliothécaire musical de Louis XIV, qui a l’idée en 1725 de mettre sur pied des séries de concerts à être offerts au public les jours où tombent les fêtes liturgiques. En effet, une trentaine de jours par année, l’Opéra fait relâche et les mélomanes sont privés de musique. Philidor négocie un accord avec Jean-Nicolas Francine, directeur de l’Académie royale de musique, et il obtient le droit, moyennant une redevance annuelle de 10 000 livres, de donner des concerts de « musique de chapelle » sur des paroles latines — d’où le nom de Concert spirituel — et de musique instrumentale.
Les voix seront celles de l’Opéra, et le Mercure de France, qui rendra compte fidèlement des activités du Concert spirituel, nous informe que « les chœurs [sont] composés de tout ce qu’il y a de meilleurs sujets de la Musique du roi, de l’Académie royale et des principales églises de Paris où il y a des chœurs de musique [et qu’]il en est de même de ceux qui composent la symphonie (l’orchestre) ». Le concert inaugural eut lieu le 18 mars 1725 de 18 à 20 heures et il fut reçu « avec l’applaudissement de toute l’assemblée ». Il avait à son programme le Concerto de Noël d’Arcangelo Corelli, une suite d’airs de violons et la Grande Pièce royale de Michel-Richard Delalande — elle fait partie des Symphonies pour les soupers du roi — ainsi que deux de ses grands motets, le Cantate Domino et le Confitebor tibi Domine.
Le Concert spirituel a élu domicile en plein cœur de Paris, au palais des Tuileries, où le roi a prêté la salle des Suisses, à l’étage du pavillon central; elle est promptement réaménagée et décorée d’après des dessins de Jean Berain.

Les Tuileries et ses jardins, gravure de Jacques Rigaud, 1730
Le Mercure nous informe qu’« on a construit […] une espèce de tribune en amphithéâtre […] élevée de 6 pieds sur 36 et de 9 de profondeur ». Il la décrit ainsi : « Cette tribune […] qui peut contenir au moins 60 [musiciens], est fermée par une balustrade rehaussée d’or, dont les balustres, en forme de lyre, sont posées sur un socle peint en marbre. Tout le mur sur lequel la tribune est adossée est décoré d’une perspective de très bon goût, qui représente un magnifique salon […] éclairé par 12 lustres et par quantité de girandoles garnies de bougies [et] qui offre un point de vue très agréable. »
Parmi les œuvres les plus goûtées du public figurent les grands motets, ou « motets à grand chœur », de Delalande, qui se maintiendront au programme jusque dans les années 1760. On donne aussi les petits et les grands motets de Lully, de Campra, de Bernier, de Couperin et de bien d’autres. Sur le plan de la sociologie musicale, il est intéressant de noter que c’est la première fois qu’on applaudit en concert et pour leurs seules qualités musicales des œuvres d’abord conçues pour les fonctions liturgiques de la Chapelle royale : cette laïcisation des musiques spirituelles accompagne et manifeste à sa façon le lent déclin du sentiment religieux en France au XVIIIe siècle. Parallèlement, le déplacement du centre d’intérêt musical de la Cour à la Ville, de Versailles à Paris, correspond à la montée de la bourgeoisie, qui s’empare en quelque sorte, en payant sa place au concert, d’œuvres qui n’avaient jusque là que les nobles pour auditeurs, créant la notion moderne de « public ».

Michel-Richard Delalande

Nicolas Clérambault
En 1727, le Concert spirituel obtient la permission de donner des musiques profanes en français et en italien, et on assiste alors à la multiplication des divertissements mythologiques et des cantates de toutes dimensions, comme Le soleil vainqueur des nuages, composée par François Colin de Blamont à l’occasion de la fin d’une maladie du jeune Louis XV — sa cantate Didon a été chantée quatre fois en 1727 et 1728 par Marie Antier, « première actrice de l’Académie royale ». Les cantates de Nicolas Clérambault figurent très souvent au programme, et Orphée est chantée par Nicole Le Maure cinq fois en 1728 et 1729.
Le Concert spirituel ne contribue pas de façon significative au développement de la musique vocale, religieuse ou profane, puisqu’il reprend des œuvres déjà publiées ou écrites pour d’autres institutions; sur le plan de la musique instrumentale cependant, il tient un rôle de premier plan. À une époque où les virtuoses sont aussi des compositeurs, beaucoup de musiciens écriront pour les instruments les plus divers et publieront par la suite les œuvres qui leur permettent de briller au Concert spirituel. Les virtuoses qui remportent un grand succès sont d’abord les violonistes. Jean-Pierre Guignon, originaire de Turin, joue ses sonates ainsi que les concertos de Vivaldi; il est suivi de près par Baptiste Anet, Jacques Aubert, Jean-Baptiste Senaillé et surtout par Jean-Marie Leclair, qui fait ses débuts en 1728.
Malgré son succès auprès du public, le Concert spirituel connaît en 1728 ses premières difficultés financières. Philidor donne sa démission et c’est Pierre Simard, administrateur, et Jean-Joseph Mouret qui prennent la tête de l’institution, sans régler cependant les problèmes budgétaires. À cette occasion, on peut lire dans le Mercure une description de la tâche du directeur musical : « Le Sieur Mouret, auteur de plusieurs ouvrages de marque, connus et estimés du public, est chargé du choix des sujets qui se présenteront pour être admis au Concert, de même que de toutes les pièces qui y seront chantées et de leur exécution. » Durant les cinq années pendant lesquelles il est directeur du Concert spirituel, Mouret mettra l’accent sur la musique profane, faisant jouer cantates et divertissements de sa plume.

La soprano Marie Antier

Pierre Gabriel Buffardin
Des voix célèbres, qui toutes connaissent également de grands succès de scène, se produisent régulièrement au Concert spirituel, comme Marie Antier et sa rivale Nicole Lemaure. Deux grands interprètes de Rameau font leurs débuts en 1733, Marie Fel, qui terminera sa carrière en 1769, et le ténor Pierre Jélyotte, un des chanteurs les plus aimés de son temps. On donne également de plus en plus de musique italienne. Giovanni Bononcini, de retour de Londres, fait jouer plusieurs de ses motets, dont un Miserere « admirable dans toutes ses parties ». Les concertos de Vivaldi et de Geminiani sont très appréciés, et de plus en plus de virtuoses italiens de passage se font entendre.
Bien que le violon reste l’instrument préféré du public, tous les instruments ont leurs amateurs, et la flûte, lorsqu’elle est jouée par Gabriel Buffardin — il donne quelques concertos en mars 1726 et en mai 1737 « avec toute la précision, la vivacité et la justesse imaginables » — ou Michel Blavet, suscite l’enthousiasme. Joseph Bodin de Boismortier compose, le premier en France, sonates et concertos pour le violoncelle et/ou le basson — qui fait son entrée comme soliste au Concert spirituel en 1731 dans des concertos non identifiés — et on n’échappe pas à l’engouement momentané du public pour les instruments champêtres, comme la musette et la vièle à roue, malgré que certains critiques déplorent ce « faible étonnant pour la bergerie ».
En 1734, Mouret se retire du Concert spirituel, et l’Académie royale de musique assurera dorénavant la gestion de l’institution, rétablissant sa santé financière. Ce sont Jean-Féry Rebel et François Francœur qui prennent alors la direction musicale. De nouveaux noms de musiciens font leur apparition au programme à côté des Guignon, Leclair et Blavet, parmi lesquels celui de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, qui fait ses débuts comme virtuose du violon. Après diverses œuvres instrumentales, dont un concerto à trois chœurs et, le 8 décembre 1749, sa première Sonate en symphonie, — orchestration du premier groupe de ses Pièces de clavecin en sonates avec accompagnement de violon, parues 14 ans plus tôt —, ses grands motets seront chantés à partir de 1737 et ils remplaceront lentement ceux de Delalande dans la faveur du public.
En 1748, le privilège d’exploitation échoit à Pancrace Royer, « maître de musique des enfants de France », et à Gabriel Capperan, violoniste à l’Académie royale. Pendant une courte suspension, la salle de concert est refaite afin, nous dit le Mercure, « de plaire aux dames par sa distribution commode et l’arrangement des places ». Un grand orgue est placé au fond de la scène, qui sera touché par Claude Daquin entre autres virtuoses, et qui servira, de préférence au clavecin, à la réalisation des basses continues.

Joseph Bodin de Boismortier

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Le public entend à cette époque de jeunes virtuoses qui font valoir leur talent, comme le castrat Caffarelli et les violonistes Gaetano Pugnani, élève de Tartini, et Pierre Gavinies, élève de Leclair. Mais la musique germanique s’affirme lentement à partir du milieu du siècle et le Concert spirituel parisien témoignera très tôt de l’évolution des productions des maîtres autrichiens et allemands. Ainsi en 1736, on peut entendre « un air italien du fameux M. Handel » et, deux ans plus tard, Georg Philipp Telemann, de passage à Paris, offre à ses hôtes son grand motet Deus judicium tuum regi da écrit dans ce style français dont il est un fervent admirateur et qui sera « fort goûté ».
Mais, à partir des années 1750, manifestation majeure du génie musical allemand, ce sont les nouvelles symphonies, signées Johann Stamitz, Ignaz Holzbauer, Christian Cannabich ou Joseph Haydn, qui arrivent de plus en plus nombreuses des pays germaniques, remportant les plus grands succès. L’orchestre du Concert spirituel augmente sensiblement ses effectifs avec le temps, au contraire du chœur, qui voit son importance diminuer progressivement.
Puis, quatre décennies plus tard, le Concert spirituel cessera ses activités en mai 1790, en pleine Révolution.
© François Filiatrault, 2025
![Concert_spirituel_au_Château_des_[…]_bpt6k857564w](https://www.boreades.com/wp-content/uploads/2025/04/Concert_spirituel_au_Chateau_des_._bpt6k857564w.jpg)
Le concert CONCERT SPIRITUEL 1730 sera présenté vendredi 16 mai 2025 à 19h30 à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque.